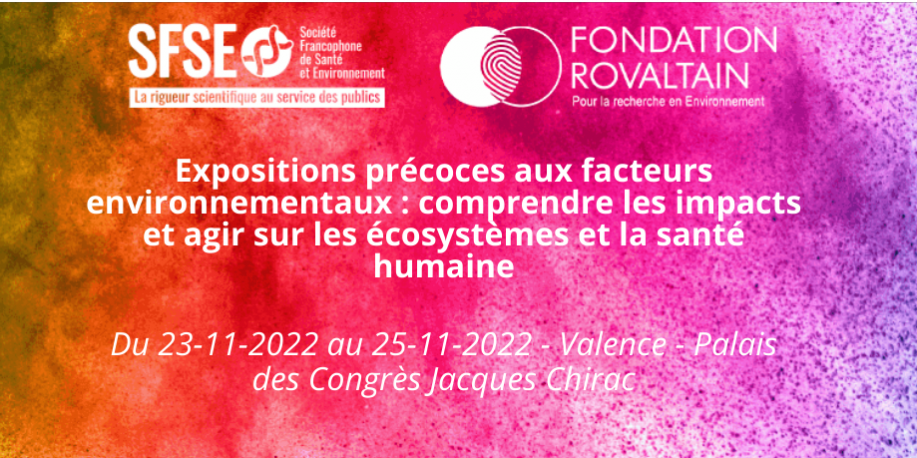SFSE – du 23 au 25 novembre 2022
Résumé
Le 13ème congrès de la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE), co-organisé avec la Fondation evertéa portait sur le thème suivant « Expositions précoces aux facteurs environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les écosystèmes et la santé humaine ». Il a permis de réunir des chercheuses et chercheurs de différents domaines, de l’écotoxicologie à l’épidémiologie, en passant par la toxicologie humaine, mais également des représentant.es d’associations et de collectifs citoyens engagé.es pour la préservation de la santé et la sensibilisation aux expositions précoces aux facteurs environnementaux. Le programme du congrès, construit autour de 3 axes complémentaires, a permis une progression et une suite logique des thématiques.
- Ainsi, la première partie du congrès a permis d’aborder l’état des connaissances fondamentales sur les expositions précoces aux facteurs environnementaux, notamment les contaminants chimiques seuls ou combinés à d’autres facteurs de stress, aussi bien chez l’homme que chez l’animal.
- La seconde partie portait quant à elle sur la santé humaine, allant de l’évaluation des risques aux mesures de gestion, que ce soit à travers la priorisation des effets sanitaire ou des plans de lutte contre les expositions reprotoxiques et les causes d’infertilités.
- Enfin, la dernière partie du congrès était consacrée à la transmission des informations vers le grand public, et la sensibilisation aux expositions à des facteurs environnementaux à différents niveaux, i.e. soignant.es, sage-femmes, instituts liés à la petite enfance, citoyen.nes, décideurs politiques, mettant ainsi en lumière le rôle essentiel des associations et collectifs citoyens pour diffuser ces informations à tous les niveaux. Pari réussi, donc, pour ce congrès, où les chercheuses et chercheurs de domaines parfois très différents ont pu échanger et confronter leurs expériences, notamment au cours des différentes tables rondes et où la progression du congrès, de la connaissance à l’action, a permis de mettre en avant des mesures concrètes de gestion et de sensibilisation.
Conférences introductives
Les conférences introductives ont permis d’aborder de manière transversale les différents axes de ce congrès, en mettant en avant les notions de contamination globale, d’exposome et de santé unique (Une Seule Santé). Sur ce dernier point, il est important de rappeler ici que le déclin de la biodiversité, et en particulier la déforestation, a un impact direct ou indirect sur la santé humaine.
La conférence du Professeur Laurent STORME – Impacts de l’environnement précoce sur la santé future – a donné le ton du congrès côté santé humaine, en mettant en avant les différents facteurs d’exposition, qui à des stades précoces, in utero ou au cours des 1000 premiers jours, peuvent avoir des effets délétères sur la santé des futurs adultes. Un des principaux messages à retenir est que plus l’on est exposé précocement à des contaminants ou autres facteurs de stress, plus on risque de développer tôt dans la vie des pathologies qui seraient apparues plus tard (ou jamais) sans expositions. S’ajoutent à cela divers autres facteurs qui vont avoir une influence sur l’organisme, notamment sur le développement du microbiote. Ainsi, des études ont montré qu’allaiter l’enfant et donner naissance par voie basse plutôt que par césarienne favorisait le développement du microbiote de l’enfant et permettait pour lui un moindre risque de développer certaines pathologies.
Par la suite, la conférence du Dr Sabrina KRIEF – Malformations et expositions à la pollution environnementale : les chimpanzés sauvages, sentinelles pour la santé humaine – a permis d’ouvrir la réflexion avec une étude de terrain sur l’exposition environnementale aux pesticides de chimpanzés vivant à proximité de cultures de thé et de maïs dans la région de Sébitoli en Ouganda. La mise en évidence de malformations chez les singes, notamment au niveau du nez et des doigts, a permis aux populations humaines locales de prendre conscience de l’effet néfaste des pesticides utilisés dans leurs cultures. En ce sens, les chimpanzés ont joué le rôle de sentinelle pour les hommes, et des actions concrètes de gestion ont pu être mises en place localement, avec le passage en bio et la réduction drastique de l’utilisation de pesticides.
Cette session, basée sur l’exposome et les conséquences de ces expositions a montré, au travers d’exemples concrets, la complexité du travail des chercheurs en toxicologie et en ecotoxicologie autour de l’effets des facteurs environnementaux sur la santé animale, et sur la santé humaine. Abordant des thématiques aussi variées que celle de l’exposition aux retardateurs de flammes chez la femme enceinte, jusqu’à celui des PCBs sur une espèce piscicole, plusieurs problématiques communes à la toxicologie humaine et à l’écotoxicologie ont été exposées. Parmi elles, la nécessité de trouver des modèles appropriés, ainsi que des marqueurs d’effets, les plus fiables et transversaux possibles. Cette session a également mis en avant l’importance du microbiote intestinal, sujet à de nombreuses modifications en présence de contaminants, ainsi que l’axe microbiote intestinal/barrière hémato-encéphalique, identifié comme un axe novateur et d’importance dans le suivi des changements physiologiques et cellulaires majeurs associés à l’effets des contaminants. A noter également la mise en lumière de l’importance de l’effet sur les organismes des produits chimiques, mais également de leurs produits de dégradation, en lien, notamment, avec le changement climatique.
Au travers de l’utilisation de cohortes, de données épidémiologiques et d’études bibliographiques, les communications présentées ont rassemblé des sujets variés, tels que l’étude des effets de la pollution de l’air sur les fonctions cognitives de l’enfant, l’impact neurodéveloppemental d’une exposition aux produits phytopharmaceutiques, et l’étude des effets reprotoxiques chez les patients infertiles. Trois informations novatrices générales sont ressorties de cette session : l’exposition d’un individu peut ne pas avoir un effet toxique immédiatement visible et concrétisé sur sa santé, mais intervenir plus loin le long des générations, et affecter la santé des générations suivantes et notamment la F3, impliquant que l’exposition aux facteurs environnementaux des grands-parents pourrait influencer et faciliter l’apparition de maladies environnementales chez les petits-enfants, même en l’absence pour ces derniers, d’exposition nocives au cours de leurs vies. L’axe 2 a également mis en lumière le rôle important du père, nouveauté dans le sujet d’études concernant l’enfant à naître, sa santé et son développement. Il a été notamment mentionné le rôle important de la mise en place d’une vie saine pour les pères, ainsi que le rôle fondamental des expositions auxquelles ils ont été soumis afin de diminuer les risques reprotoxiques et le développement de maladies chez les enfants. Cet axe a également insisté sur la nécessité d’informer et de sensibiliser les jeunes parents ou jeunes parents en devenir sur ces risques et de les accompagner, notamment en développant la mise en place de référents qualifiés le long du parcours santé comme développé dans l’axe 3.
Ce dernier volet du congrès a rassemblé des personnes d’horizons divers, i.e. Associations, Instances Régionales de Santé, Centre Clinique, Mutuelle, afin de présenter les actions de transmission mises en œuvre sur le terrain à destination de différents publics, i.e. les soignant.es, les sage-femmes, les instituts de la petite enfance, le tout public, et enfin les décideurs.
Les connaissances transmises se font principalement au cours d’atelier de sensibilisation aux expositions du quotidien et leurs effets sur la santé, que ce soit celle des parents, comme l’infertilité et la reprotoxicité, ou celle des premiers stades de la vie, avec les pathologies liées au développement du fœtus et de l’enfant (période critique des 1000 premiers jours). Une des principales difficultés des ateliers de sensibilisation est de transmettre l’information sans être anxiogène, la liste des expositions du quotidien pouvant être culpabilisante pour les futurs parents.
Les principales sources d’expositions sont l’air intérieur des logements ou des crèches, l’alimentation, ou encore les cosmétiques, mais aussi les jouets. L’exposition aux perturbateurs endocriniens a beaucoup été évoqué, et des associations, françaises ou québécoises, ont présenté leurs actions auprès des décideurs, pour sensibiliser et limiter les expositions.
Cet axe a également fait ressortir le rôle essentiel des associations ou collectifs de citoyen.nes pour faire remonter l’information à tous les niveaux, et notamment aux décideurs.
Les discussions ont également fait remonter l’importance de fédérer en réseau les associations et collectifs citoyens pour partager l’information et les retours d’expérience.